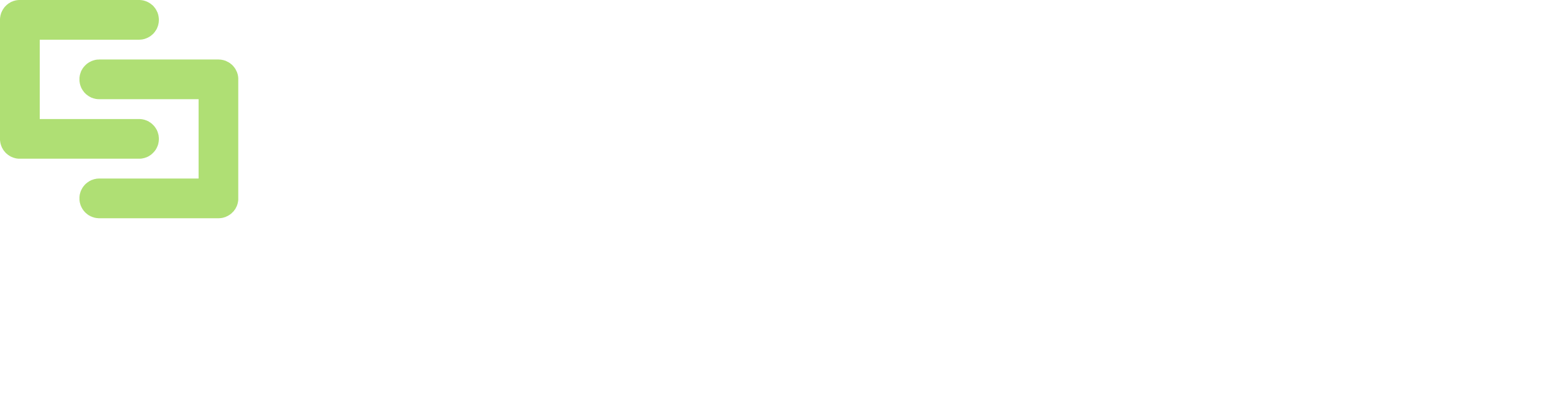Dans une opération de small ou mid-cap, tout converge vers un constat simple : la valeur future dépend d’abord des femmes et des hommes qui devront exécuter la thèse d’investissement. Pourtant, au milieu des classeurs, des datarooms et des modèles, la part humaine reste la moins documentée. On mesure les chiffres au micron, on jauge les équipes à l’œil nu…. et encore si l’on a eu la chance d’y avoir accès et de les avoir rencontrées. Ce paradoxe traverse la plupart des transactions et pèse, silencieusement, sur la réalisation des plans.
Pourquoi cet angle mort persiste
Le temps du deal est court. On s’attache à ce qui se laisse extraire vite et comparer bien.
Le passé rassure. Un track record solide devient promesse, alors qu’il n’est souvent qu’un contexte.
Le récit séduit. Un CEO charismatique ou un collectif soudé peuvent faire oublier les zones d’ombre : qui décide vraiment, comment tranche-t-on, que se passe-t-il quand la pression monte.
Ce qu’il faudrait regarder, avec méthode
L’individuel d’abord. Non pas un « talent » abstrait, mais l’adéquation à la thèse : savoir passer de “doer” à “builder”, arbitrer sous contrainte, tenir une cadence, renoncer aux mauvaises batailles.
Le collectif ensuite. La façon de décider, la clarté des rôles, la qualité des rituels, la redevabilité. Un operating model n’est pas un organigramme : c’est un ensemble de promesses tenues semaine après semaine.
Vers un standard sobre et utile
Il ne s’agit pas d’ajouter une couche de jargon. Il s’agit d’installer un réflexe : évaluer systématiquement le pouvoir d’exécution au même titre que les flux de trésorerie.
Une trame suffit :
- Lier l’évaluation à la thèse d’investissement, pas à un idéal théorique.
- Examiner le noyau dirigeant sur pièces et en situation, puis croiser avec des références ciblées.
- Observer le collectif au travail : décisions, interfaces, rythmes.
- Tirer des conséquences concrètes dans le pricing du risque, la gouvernance et les actions post-deal à mettre en place.
- Mesurer l’adoption à 30/60/90 jours, comme on suit un covenant.
Ce que nous voyons sur le terrain
Chez Selescope, notre métier nous place au cœur de cette zone parfois floue. Notre pratique, fondée sur des sous-jacents scientifiques (psychologie différentielle, systémique, sociologie), associe expérience humaine, méthodologie et outils.
Les nôtres sont robustes et scientifiquement validés, ils apportent un éclairage indispensable aux consultants, sans prétention d’exhaustivité :
- Myscope éclaire l’individuel (capacités cognitives et personnalité) : entretiens structurés, mises en situation, préférences décisionnelles. L’objectif n’est pas de juger des personnes, mais de tester une adéquation à un cap.
- Scopexec éclaire le collectif : observation des circuits de décision, qualité des rituels, clarté des rôles, maturité de pilotage. On y lit la probabilité que le plan vive au quotidien.
Cette double lecture ne promet rien qu’elle ne puisse étayer. Elle cherche à réduire l’aléa, à nommer les risques, à proposer des gestes simples : renforcer ici, coacher là, recruter ailleurs, parfois refonder un rituel.
Pour mémoire
Selescope conduit chaque année plus de 2 000 assessments individuels et plus de 50 missions de Management Due Diligence / Due Diligence RH / Revue d’organisation en France et à l’international. Non comme un label, mais comme une base de comparaison qui permet de situer une équipe dans un paysage plus large.
En guise de conclusion
Les chiffres racontent le passé. Les équipes écrivent l’avenir. Il est raisonnable d’exiger pour elles le même niveau de preuve que pour une liasse financière. Systématiser l’évaluation du management n’ajoute pas du bruit au deal. Cela retire du hasard à la création de valeur.
Par Damien Leblond